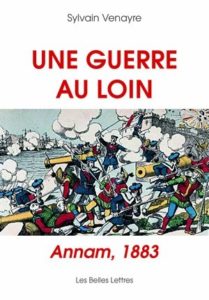Sylvain Venayre
Paris, Les Belles Lettres, 2016, 168 p.
Sylvain Venayre a obtenu pour ce livre le prix Augustin-Thierry. Augustin Thierry incarne cette figure séminale de l’« historien » en marche sur le chemin de crête qui sépare les agonisantes « belles-lettres » de l’émergente « science » historique. Connu pour ses aventures hybrides aux marges de l’histoire et de la fiction (une « recherche-création » transformant la partie biographique de son HDR [habilitation à diriger des recherches] en une œuvre à part entière [Disparu ! Enquête sur Sylvain Venayre] en 2012 ; un compagnonnage avec le romancier Thomas B. Reverdy en 2017 pour Le Jardin des colonies), Sylvain Venayre était le récipiendaire idéal.
A priori, Une guerre au loin est une réflexion sur la façon dont on écrit l’histoire. Officier de marine, écrivain, journaliste, correspondant de guerre, Julien Viaud/Pierre Loti est un homme aux persona contradictoires. En 1883, il rend compte pour Le Figaro de la prise des forts de Hué. Son récit, « très improprement factuel » selon Venayre (p. 53), provoque des réactions violentes : la collaboration est interrompue, l’officier est mis aux arrêts, et c’est un autre écrivain, Paul Bonnetain, qui prend la relève. Que reproche-t- on au juste à Loti ? d’avoir manqué à son devoir de réserve en écrivant ? d’avoir montré que la guerre de conquête n’était pas une guerre « propre » ? d’avoir cédé aux vertiges du romanesque en racontant une scène dont il n’a même pas été témoin ? Le récit, caviardé, sera ensuite republié. Pour le faire connaître, Venayre prend son temps, rejouant l’histoire des amours de Jacques dans Jacques le Fataliste.
Tout au long du livre, Venayre s’interroge sur la fabrication de ce « récit national » de la colonisation, sur le pouvoir de la presse, sur les émotions des soldats (leur folie ? ), celles des lecteurs (la pitié), sur le statut du témoignage, faisant sans cesse des ponts, parfois bien hardis, avec notre période, le « syndrome post-traumatique », le Rwanda, l’engagement. Venayre découpe un moment « historique » : celui où, selon lui, le paradigme de la guerre change – le « dulce et decorum » épique et antique s’usant devant les descriptions de la « boucherie de la guerre » ; celui où s’élabore in petto ce que l’on appellera l’impérialisme ; celui où l’écriture romantique s’incline devant l’écriture naturaliste. Il se demande aussi comment le proto-journalisme de ces années, fait d’écrivains et non de professionnels de l’information, se constitue. Pourquoi confier l’élaboration d’un récit fondateur à des écrivains ? Et surtout : comment se ressaisir d’un événement auquel on n’a pas assisté, sinon par le recours aux récits « fictifs » ? Tout n’est-il pas fiction, à partir du moment où un homme prend la plume pour raconter ? L’écriture n’oblige-t-elle pas intrinsèquement au détour, à l’utilisation de procédés, et donc à une distance entre la véracité des choses vues et la stylisation fatale des choses racontées ? L’histoire fictionnelle est-elle moins « valable » que les autres ? Le récit, historique, n’est-il pas de toute façon la reconstruction d’une « succession d’instants qui fut l’histoire véritable » ? (p. 36).
Une guerre au loin est-il un ouvrage historique ? Lorsqu’il isole deux mots d’un texte, Venayre anticipe sur le reproche qu’on pourrait lui adresser en citant un roman, Un tout petit monde de David Lodge, et le « syndrome de Frobisher », du nom d’un écrivain qui découvre avec terreur son idiolecte obsessif (p. 72). On ne saurait mieux botter en touche. On aimerait davantage voir dans cet opuscule une continuation exploratoire de l’œuvre de l’écrivain qui n’ose pas (encore ? ) dire son nom – Venayre. Une clé nous est donnée dès l’épigraphe : le livre est dédié à la mère de l’auteur, « qui aime mieux la littérature que l’histoire » (on notera le délibérément pataud et vieillot « j’aime mieux… que », façon Montaigne ou Roland Topor), et « à la mémoire de [s]on père ». En bon fils, Venayre comble donc ces deux loyautés contradictoires. Guitry et Flaubert fournissent une nouvelle série d’épigraphes, les « seuils » ne manquant décidément pas dans ce livre. Venayre reprend : « les personnages de l’histoire sont plus intéressants que ceux de la fiction » – citation extraite d’une lettre de Flaubert à Duplan, écrite en 1868, quand Flaubert était en proie aux difficultés d’écriture de son roman « historique », L’Éducation sentimentale. L’ombre de Flaubert plane sur toute l’œuvre. Loti rêve de lointains comme Flaubert se rêve « empereur de Cochinchine » (p. 27). Le deuxième chapitre (« L’idiot ») ne renvoie pas tant à Dostoïevski qu’à Sartre racontant Flaubert – « l’idiot » vient de Breton, qui, dans un des premiers pamphlets surréalistes, a aligné Loti aux côtés de Barrès (le « traître ») et d’Anatole France (le « policier »). Le troisième chapitre est d’ailleurs consacré à « Gustave », le frère aîné de Julien, qui le précède dans ses voyages exotiques, et en meurt. De Gustaves fantasmés, le livre ne manque pas. La circulation des textes est intense : Venayre voit dans Salammbô un décalque des récits par les journaux de la révolte des Cipayes (p. 125), dont se serait ensuite inspiré Loti. Et le lecteur de Venayre reconnaît à son tour le « C’était à Thuan-An, faubourg de Huê, dans les forts de Tu-Duc » (p. 39), retour du refoulé Salammbô. On notera aussi d’autres intertextes : « que la guerre était jolie » (p. 47), qui renvoie à Apollinaire, et encore une fois à Breton, et le « silence des voix qui se sont tues » (p. 130), presque verlainien.
Venayre se laisse aller à sa facilité de plume tout au long des chapitres. Il parle de « Pierre », de sa chatte Belkis, de la querelle naturaliste. Il refuse les notes de bas de page, renvoyant simplement son lecteur à une bibliographie minimaliste et assez peu scientifiquement sourcée dans des « notes » finales. Aimé Césaire y devient « André » (son frère, sans doute), p. 164 ; la définition de l’exotisme par Todorov est qualifiée de « percutante », le jugement sur Tu-Duc de Charles Fourniau est « beau » (p. 153) – la bibliographie n’est pas seulement commentée, elle est constamment adjectivée. Venayre affirme pourtant que « les présentes notes sont justifiées par l’indépassable démonstration de Marc Bloch dans Apologie pour l’histoire ou Le Métier d’historien, 1949, Paris, Armand Colin, 1960, p. 40 » (p. 151). On rappelle justement que Bloch défendait, face aux partisans de la « page déshonorée », ses « humbles notes », ses « petites références tatillonnes ». Au détour d’une note justement, l’auteur se place aussi dans le sillage d’Anthony Grafton et de ses Origines tragiques de l’érudition. Une histoire de la note de bas de page (p. 157).
À la fin, les « remerciements » saluent à part égale historiens et littéraires. Le livre, de fait, peut se lire comme une série de « pastiches et mélanges ». Pastiche de Flaubert, pastiche de Proust pastichant Flaubert, pastiche d’Augustin Thierry pastichant Walter Scott ? Les titres de chapitre font « signe » : « Les chats » « L’affaire » « Les noms »… Pour les littéraires amateurs de jeux intertextuels, l’ensemble est fort plaisant – rafraichissant est le non-esprit de sérieux de Venayre qui commence un chapitre avec une chanson de Brel : « c’était au temps… » (p. 11), ancre son récit dans un temps a-historique : « Au début de cette histoire… » (p. 13)… Il est parfois aussi irritant par ses assertions péremptoires et ses effets de style faussement bonhommes (« vous me demanderez : pourquoi parlez-vous de cela ? » [p. 32], « je devine ce que vous pensez » [p. 34]). Pour les historiens, Une guerre au loin parle sans doute de l’histoire « au loin ». Mais, avec ce livre, Venayre continue son entreprise expérimentale d’écriture de l’histoire. Cet exercice de style souvent formaliste a toutefois le défaut de vitrifier la réflexion.
Publié dans Mémoires en jeu, n°5, décembre 2017, p. 137-138