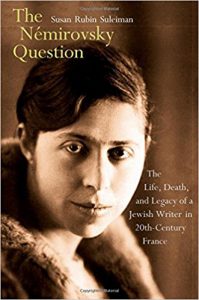The Life, Death, and Legacy of a Jewish Writer in 20th-Century France
Susan Rubin Suleiman
New Haven et Londres, Yale University Press, 2016, 376 p.
Comme le démontre Susan Suleiman dans ce livre, rien n’est simple quand il s’agit de cerner la vie et l’œuvre d’Irène Némirovsky, née à Kiev en 1903. Propulsée star littéraire dans la France de 1929 par David Golder, elle se verra néanmoins refuser la citoyenneté française et sera déportée à Auschwitz en 1942. Couronnées de gloire posthume par le succès foudroyant de Suite française, sa vie et son œuvre ont été rattrapées par l’histoire. On lui reproche la peinture de ses personnages juifs, qui souvent charrie des clichés et des stéréotypes plus que gênants (lubricité féminine, cupidité, machinations financières, nez crochus, santé fragile). D’où les accusations aussi d’une « haine de soi », d’autant que Némirovsky s’était convertie au catholicisme en 1939, faisant baptiser son mari et ses enfants. Geste complaisant ou quête spirituelle ? Aux yeux de certains, c’était une trahison. Elle va même jusqu’à adresser une lettre à Pétain, lui demandant un traitement de faveur.
Le cas Némirovsky s’avère ainsi troublant. Comment arriver à une appréciation juste et cohérente, sans dénigrer son indéniable talent littéraire et sans passer sous silence ses compromissions ? Revenant sur la réception critique, tenant compte des multiples facettes de son œuvre, Suleiman nous propose une lecture savante visant à donner une compréhension lucide de la figure littéraire et de la personne qu’elle considère en tous points comme attachante. Exercice délicat : de la question Némirovsky englobant tant d’autres, il fallait, sans se dresser en justicier, arriver à des appréciations justes. Les défis sont donc nombreux, les risques lourds et les enjeux de taille, car le cas Némirovsky engage des perspectives sur la Shoah et l’identité juive. En recourant aux archives et en s’attachant à reconstruire les parcours sinueux des personnes et des manuscrits, Suleiman parvient à mener à bien son projet. Refusant toute logique binaire, l’auteure sonde l’ensemble des ambivalences de son objet.
Ainsi, la question de la « haine de soi » serait en fait un paradigme observable partout où une culture minoritaire doit faire face à une culture dominante. Prendre du recul vis-à-vis de sa propre culture, émettre des critiques pour marquer son autonomie, c’est faire naître des soupçons de trahison. Cela se comprend : un groupe peu assuré de sa place au sein d’une société dominante craint que des images peu flatteuses fassent du tort au groupe dans son ensemble. Mais ce qui apparaît comme un stéréotype offensant se fonde parfois sur un phénomène observable. Interrogée à plusieurs reprises sur ses portraits de financiers juifs rapaces, interlopes et de santé défaillante, Némirovsky répond : « C’est comme ça que je les ai vus. » (p. 144) Cette cruauté de Némirovsky dans sa peinture des personnages juifs exprime son propre rapport à la judaïté (p. 144). « One cannot get rid of Jewishness, even if one tries », affirme Suleiman (p. 289). La judaïté de Némirovsky se trouve là où on l’attendrait le moins, dans le style, ce style indirect libre qui fait glisser la perspective de la narration de l’extérieur à l’intérieur de ses personnages. Il en résulte une riche juxtaposition de vues contrastées, dissonantes et ironiques. Voilà qui fait écho à la situation de Némirovsky, résidente non citoyenne en France se réclamant de la langue et de la littérature françaises sans pour autant renier ses racines russes ni son ascendance juive. Némirovsky se trouve toujours entre les cultures : prenant du recul, jamais pleinement intégrée, elle porte un regard extérieur révélateur de ce qui reste invisible ou non dit.
Utilisé instinctivement au début, savamment déployé ensuite, ce style indirect libre augmente la profondeur savoureuse de son art du portrait, mais laisse planer une ambiguïté, car il peut donner lieu à des interprétations différentes. Sans pouvoir décider si telle ou telle évocation d’un personnage juif vient de Némirovsky ou appartient à l’un de ces personnages, il faut se garder de jugements hâtifs. Ainsi, souvent, au lieu de présenter ses personnages d’un point de vue omniscient, Némirovsky les fait apparaître à travers les yeux des autres. Les représentations sont ainsi ancrées dans des subjectivités intérieures au récit, lesquelles, au lieu de nous livrer une vérité « objective », se révèlent elles-mêmes en montrant les êtres, les choses et les actions au prisme de leurs propres particularités.
Némirovsky représente donc ses personnages juifs tels qu’ils sont vus par d’autres Juifs et non tels que la société ou les personnes non juives peuvent les voir. Cherchant à se construire en déconstruisant les autres, ces personnages renvoient aux préjugés et aux brimades antisémites qu’ils doivent partout affronter. S’arrêtant par exemple sur David Golder, Suleiman explique qu’en allant acheter du gefilte fish rue des Rosiers à Paris, Fischl ramène Golder à ses racines. Mais, aux yeux de Golder, Fischl devient son sosie. D’où l’antipathie de Golder : Fischl ressemble trop au « Juif » des antisémites (p. 161). À la fin du roman, Némirovsky rattache toutefois le héros à ses origines. Ayant conclu une dernière affaire juteuse en Union soviétique, Golder finit par mourir sur le bateau qui le ramène en Europe. Juste avant son décès, il se met à parler yiddish avec un jeune Juif qui, comme lui des décennies auparavant, avait quitté la misère et l’oppression de son pays natal pour aller faire fortune en Europe. Ayant toute sa vie tenu à s’éloigner de ses premières années dans un shtetl, Golder meurt dans le souvenir de son enfance. Retrouvailles culturelles ou déterminisme « racial » ? Impossible d’en nier l’ambiguïté. « [R]ien n’est simple », conclut Suleiman (p. 165).
L’auteur de The Némirovsky Question nous convie à aller au-delà des évidences supposées : il faut porter notre regard plus loin pour comprendre Némirovsky, la resituer dans une multiplicité de significations qui, loin de s’opposer ou de s’exclure, s’ajoutent et se surimposent les unes aux autres. Se manifestent ainsi, comme dans la fiction fort différente d’Albert Cohen, les contradictions, bonheurs et chagrins de l’existence juive dans le monde moderne. « For many individuals, in life as in fiction, Jewishness is a bitter heritage and even a mere “Jewish origin” is a burden, especially in hard times. » (p. 289) C’est ainsi que, pour figurer la vie et l’œuvre de Némirovsky dans toute sa complexité, Suleiman rappelle l’itinéraire de Solal, un des personnages clés de la fiction d’Albert Cohen, héros du livre éponyme : ayant atteint la réussite professionnelle en devenant ministre, ayant d’autre part acquis le prestige social en épousant une aristocrate catholique, Solal croit abandonner définitivement son héritage juif, allant jusqu’à répudier publiquement son propre père, un rabbin. Il n’en finit pas moins par accueillir toute une population juive dans le sous-sol de son château.
L’examen minutieux des archives a réservé à Suleiman quelques surprises. Il y a par exemple le fait qu’en 1930 Némirovsky a refusé de se faire naturaliser, démarche obligatoire pour être candidate au prix Goncourt : à cette date, l’acquisition de la citoyenneté était envisagée par elle comme une adhésion nationale sincère qui ne devait pas être instrumentalisée. Autre surprise : préparant Les Chiens et les loups, Némirovsky dit dans ses carnets apprécier Bagatelles pour un massacre, un des pamphlets antisémites les plus violents de Céline (p. 267). On est frappé de constater la richesse de la production de Nemirovsky dans les années 1940-1942 : en l’espace de deux ans, on ne compte pas moins de quinze contes, trois romans et une biographie de Tchekhov, auxquels s’ajoute Suite française, alors qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de se faire publier. C’est que, comme nous l’explique Suleiman, au fond, Némirovsky avait fait un choix bien conscient : même sans autre possibilité qu’une œuvre posthume, elle s’acharnait à écrire, car c’était l’écriture qui constituait son identité : « for writing was what made her who she was » (p. 126).
Publié dans Mémoires en jeu, n°3, mai 2017, p. 143-144