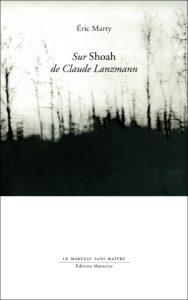Éric Marty
Paris, Éditions Manucius, coll. « Le Marteau sans maître », 2016, 121 p.
Le dernier ouvrage d’Éric Marty regroupe une série de textes et de communications autour du film fleuve de Claude Lanzmann, Shoah, qui avait avait déjà donné lieu à plusieurs publications d’importance (notamment Deguy et coll.). Le recueil de Marty couvre la période de 2010 à 2015. Chaque étude est pour lui l’occasion de porter son attention sur un point crucial qu’il questionne chaque fois à partir d’une ou deux scènes ou de quelques figures testimoniales du film. Cet attachement fréquent à quelques détails, à quelques phrases, voire à une séquence, finit par relever d’une herméneutique de la totalité de l’œuvre de Lanzmann.
Dès son introduction, Marty annonce un parti pris qu’il ne quittera jamais : aborder Shoah comme une œuvre poétique et non pas comme un moment de l’histoire du témoignage. Claude Lanzmann déclare lui-même que « Shoah, c’est une fiction du réel » (Deguy et coll., p. 301). À plusieurs reprises, Marty considère l’œuvre comme un geste profondément orphique. La mélodie inaugurale sur la barque de Charon, chantée par Simon Srebnik (celui que Lanzmann désigne sous la périphrase de « l’enfant chanteur »), cet air du folklore polonais, comme le remarque Éric Marty, ne fera revenir aucun mort. Cet enfant, que les SS ont voulu assassiner d’une balle dans la nuque, a survécu miraculeusement… C’est depuis la barque de l’enfant de Chelmno que s’engendre Shoah, depuis le chant d’un revenant.
Dans le premier chapitre, Marty se donne pour tâche de retracer, à travers l’histoire de la philosophie, les mouvements de pensée qui ont conduit Lanzmann à choisir le nom hébreu de « Shoah » comme titre de son film. Avant son film, on parlait de « génocide des Juifs », de « solution finale », d’« extermination » ou encore d’« Holocauste ». Ce dernier terme, sans doute le plus fréquent, Lanzmann le refusa en raison de sa connotation sacrificielle. Marty consacre plusieurs pages à montrer comment le nom propre d’Auschwitz a pu s’imposer, notamment à travers la pensée d’Adorno. En somme, toute la pensée de la catastrophe au XXe siècle s’articulerait, le Goulag mis à part, autour de deux noms propres symboliques, aux antipodes l’un de l’autre : « Auschwitz » et « Hiroshima », qui représentent pour Adorno les deux événements historiques de la destruction de l’homme moderne. Auschwitz s’imposait alors comme le nom propre énigmatique et difficilement prononçable de l’horreur absolue. Qu’on se rappelle, par exemple, la manière dont François Laruelle se refusait d’écrire la totalité des lettres qui forment le mot « Auschwitz ». Comme le souligne Marty, avec l’irruption du nom propre, le génocide devient « un événement métaphysique ». C’est pourquoi, en choisissant « Shoah » comme titre de son oeuvre, non seulement Lanzmann redonne au génocide sa singularité hébraïque, mais dans le même temps il invente une forme de concept. Par son geste, il appose un nom inconnu pour, selon l’expression de Marty, « inexprimer l’exprimable » (p. 42). L’énigmaticité se noue dans la prononciation même du signifiant « Shoah », seul mot hébreu incorporé par notre langue où « Sho » se prononce « Cho ». Comme s’il fallait impérativement entendre d’abord le mot avant de pouvoir le lire.
On se souvient, comme le rappelle Marty, que Shoah ne comporte qu’une seule référence biblique explicite : « Et je leur donnerai un nom impérissable », placée en exergue du film (Isaïe, 56-5, la totalité du verset est : « Je leur donnerai une demeure et un nom impérissable ». C’est à ce verset que le Mémorial de Yad Vashem doit son nom). Le verset d’Isaïe résonne avec la voix de chaque témoin convoqué dans le film. Marty consacre un chapitre particulièrement original et riche à la question du nom propre dans Shoah. Impossible ici de rendre compte précisément de la fécondité de son analyse. Je n’en donne qu’un exemple : dans la séquence consacrée à Richard Glazar, il étudie minutieusement la liste des noms qui apparaissent sur des valises noires, feu blanc sur feu noir, comme l’écriture même de la Torah, remarque-t-il. Ce chapitre de Marty, pourrait-on avancer, exhume une seconde fois des noms : après Lanzmann, il leur rend dans ce chapitre, où chaque nom est l’objet d’un questionnement, un peu de la lumière perdue.
Le quatrième moment du livre interroge un bref passage (bouleversant) du film dans lequel Philip Müller raconte comment il a été sauvé par la parole que lui adressa une femme au moment même où il voulait se suicider en entrant avec les autres dans la chambre à gaz : « Tu veux donc mourir. / Mais cela n’a aucun sens. / Ta mort ne nous rendra pas la vie. / Ce n’est pas un acte. » (Lanzmann, p. 204-205) C’est à partir de ce dernier énoncé que Marty déploie une lecture philosophique dans laquelle il repense l’éthique du témoignage comme l’acte qui se scelle lorsque l’événement du langage laisse son empreinte. Le témoignage ressuscite, par l’empreinte déposée, la puissance d’un énoncé d’un corps disparu qui, au moment de mourir dans une chambre à gaz, sut avoir le mot juste pour sauver une autre vie. On peut dire que l’acte se renverse, ce n’est plus le geste suicidaire de Müller qui fait événement, ce qui fait acte c’est la parole qui enjoint à la survie, et donc au témoignage.
Le dernier chapitre, placé en « Annexe », est résolument à part, il constitue une méditation de Marty autour de la meguilah d’Esther. L’auteur pose une question qui demeure ouverte : quelle signification le peuple juif peut-il donner à un texte saint et non prophétique, qui, quelques milliers d’années avant l’événement, anticipe son propre anéantissement ? Toute la splendeur du Livre d’Esther réside selon Marty dans sa double dimension « symbolique » et « allégorique ». Pour lui, Le Livre d’Esther « n’annonce pas une catastrophe à venir, mais une catastrophe qui a failli avoir lieu, un événement en tant qu’il est évité. Il ne menace pas, il soulage de la menace. » (p. 118)1 En ce sens, la fête de Pourim revêt pour Éric Marty une positivité qui va au-delà de la sainteté du Livre d’Esther : ce livre dévoile au peuple la possibilité de son propre effacement, par lequel peut s’affirmer son unité et son existence, en passant des pleurs aux rires.
Au terme de ce trop rapide parcours, il nous semble que nous aurions dû aussi dire quelques mots du chapitre 2, « L’événement Shoah », dans lequel Marty s’interroge sur l’idée que l’événement « dure encore », ce que, paraphrasant la langue heideggérienne, il désigne sous l’expression de « désormais toujours ». L’approche de Marty est philosophique et littéraire, il privilégie le texte plutôt que l’image cinématographique. Néanmoins, il interprète très rigoureusement certains choix esthétiques de Shoah, comme lors de cette séquence où l’on voit distinctement les noms sur les valises et où il décrit très bien de quelle manière la photographie, le cliché, se substitue finalement, d’une certaine manière, à l’image-mouvement.
L’objectif annoncé, celui de lire délibérément Shoah comme une « œuvre poétique », est parfaitement atteint. Économe de mots, Marty ne bavarde ni ne digresse, il tranche dans le vif de l’œuvre de Lanzmann, en ressaisit certaines étincelles, et ces brefs chapitres sont comme des pierres aiguisées qui nous somment de revoir Shoah avec un regard nourri de ses interprétations.
Bibliographie
Deguy, Michel, et coll. (dir.), 1990, Au sujet de Shoah. Le film de Claude Lanzmann, Paris, Belin.
Lanzmann, Claude, 1985, Shoah, préface de Simone de Beauvoir, Paris, Le Livre de Poche, 1987.
Levinas, Emmanuel, 1988, « Pour une place dans La Bible », in À l’heure des nations, Paris, Les éditions de Minuit, p. 19-41.
Publié dans Mémoires en jeu, n°4, septembre 2017, p. 135-136
1 Dans cet ultime chapitre, Éric Marty cite plusieurs textes de Levinas, mais jamais celui que le philosophe consacre au Livre d’Esther (Levinas). L’étude talmudique de Levinas porte sur la discussion des rabbins à propos de l’intégration ou non du Rouleau d’Esther dans la Torah.