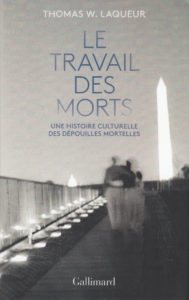Traduit de l’anglais par Hélène Boraz, Gallimard, 2018, 928 p.
Comme c’est souvent le cas pour une étude d’une telle ampleur – et à laquelle ce compte-rendu trop rapide est loin de pouvoir rendre justice –, le sous-titre de l’ouvrage de Thomas W. Laqueur est trompeur, car nécessairement réducteur. Cette « histoire culturelle des dépouilles mortelles » est en effet bien plus que ce qui est annoncé : il s’agit plutôt d’une histoire totale d’un fait culturel, le « travail des morts », où sont abordés les nombreux enjeux dont peut relever la question de ces dépouilles, des représentations et des pratiques qui leur sont liées, enjeux religieux et spirituels bien sûr, mais aussi juridiques, administratifs, médicaux, économiques, techniques, écologiques… Cet effort d’exhaustivité dans le traitement du sujet aboutit à un va-et-vient constant entre toutes les échelles. L’auteur se place ainsi, à l’occasion, et en complément d’une démarche purement historienne, du point de vue de la longue durée anthropologique (notamment dans la première partie), offrant des raccourcis, parfois vertigineux, allant de l’époque des bûchers homériques à celle du mémorial du 11-Septembre. Mais son œuvre est avant tout celle d’un historien, enquêtant sur des évolutions et des ruptures bien identifiées entre des contextes précis, qui lui font mobiliser tant l’échelle de la psychologie individuelle que celle des nations et de groupes sociaux spécifiques, jusqu’aux enjeux plus larges de la cuture occidentale. Car c’est cette dernière qui est privilégiée dans ce travail, et singulièrement le monde anglophone. On pourra juger l’auteur trop européocentriste (d’autant qu’il n’évoque que de façon accessoire les autres aires culturelles), et lui en faire le reproche ; mais comment imaginer une histoire mondiale des dépouilles mortelles, quand l’ouvrage en question atteint presque les mille pages, dont 135 sont consacrées aux seules notes et références ? Une vie n’y suffirait sûrement pas, fût-elle celle de quelqu’un d’aussi érudit et documenté que Thomas W. Laqueur.
L’auteur s’inscrit dans une tradition historiographique déjà bien développée, celle de l’histoire de la mort dont il rappelle les principaux tenants, notamment français (Vovelle, Ariès, Foucault), mais pour mieux s’en démarquer, et ce de deux façons. D’abord, par son angle de vue : non pas la mort, comme fait physiologique faisant culture en produisant sur l’imaginaire tout une série de fantasmes, mais le corps mort, en tant qu’objet et enjeu de représentations et de pratiques culturelles ; ensuite, par une révision de l’idée de rupture au XVIIIe siècle : là où beaucoup voient une forme de désenchantement, lui préfère voir « la réinvention d’un enchantement plus démocratique » (p. 33), dont témoignent tant l’essor du jardin-cimetière que la généralisation des listes de noms de défunts, incluant désormais jusqu’aux moins fameux d’entre eux (à commencer par les simples soldats dûment inventoriés sur les divers types de mémoriaux). Cette double question, celle des lieux des morts (nécro-géographie) et des noms des morts (nécro-nominalisme) font l’objet des deuxième et troisième parties du livre, les plus développées de l’ouvrage.
La question de la mémoire des morts y occupe une place centrale, mais en filigrane seulement, car aucune partie du plan, comme de l’ouvrage en général, ne lui est spécifiquement consacrée. Elle n’est qu’un aspect parmi d’autres de la façon d’appréhender ce que l’on fait des dépouilles mortelles, et pourquoi. L’enjeu du souvenir de la personne décédée, et de ce pourquoi elle est décédée (notamment pour les victimes des guerres) n’est qu’un paramètre parmi d’autres de la gestion des corps morts, qu’il s’agisse de leur localisation post-mortem, ou de leur nominalisation.
Sur la question des lieux des morts, le propos principal de l’auteur est de montrer comment les XVIIIe-XIXe siècles voient la transition lente – et pour tout dire, jamais totalement achevée – entre le modèle du cimetière paroissial qui domine dans l’Europe moderne, et celui du cimetière-jardin, dont l’archétype est le Père-Lachaise, ouvert à Paris en 1804. Cette évolution marque un changement du régime de com- mémoration des morts. L’ancien cimetière paroissial n’était pas un lieu de la commémoration individuelle des défunts : il ne s’y trouvait aucun marquage durable de leur présence (comme les stèles), les monticules de terre indiquant leur localisation étant rapidement condamnés à disparaître, en raison de la réutilisation permanente du terrain pour laisser place à de nouveaux corps. À ce cimetière d’ancien régime « dédié au souvenir d’une communauté locale des morts » se substitue, au tournant des XVIIIe et XIXe siècles, le cimetière-jardin, lieu de mémoire d’un type nouveau, où la présence pérenne du défunt s’incarne dans des monuments plus ou moins ostentatoires, et de façon sécularisée : le culte des morts ne sert plus à Dieu mais à de nouvelles entités, « la famille, la société civile, la nation, les classes sociales, l’histoire » (p. 292). La généralisation, à partir des années 1870, de la crémation (traitée dans la quatrième et dernière partie de l’ouvrage), n’introduit pas de rupture brutale dans ce nouveau régime nécro-géographique et mémoriel : le corps réduit à l’état de cendres, s’il semble constituer une impossibilité de la perpétuation du corps mort et de son souvenir pour certains contemporains, se voit en effet rapidement attribuer des lieux de conservation qui permettront, à leur tour, l’entretien de la mémoire.
Dans ces lieux nouveaux, la question du nom des morts devient – et c’est là l’autre évolution majeure que traite l’ouvrage – un véritable enjeu. L’auteur rappelle en effet que les noms « évoquent, commémorent, signalent et représentent les défunts » (p. 491), et ce depuis l’Antiquité. Leur collecte et leur transcription, sur des stèles ou des registres, permettent la création d’une mémoire communautaire, que ce soit à Marathon, à Azincourt ou à Gettysburg. Cette collecte des noms des morts ne renvoie certes pas uniquement à un impératif mémoriel : elle relève aussi, « à l’intersection entre l’intime et le bureaucratique » (p. 530), d’un besoin légal (pour la justice, les assurances, le fisc…), et d’un besoin émotionnel et moral. Aussi entre-t-on, à partir du XIXe siècle – même si des formes de prise en compte de ces diverses préoccupations sont antérieures, comme le développement des formes d’état civil et des nécrologies – dans l’ère du nécro-nominalisme. Celle-ci est marquée par un effort sans précédent de collecte des noms des morts, en réponse à un nouvel « impératif moral » (p. 551), celui de ne pas oublier, presque un devoir de mémoire, qui va se concrétiser autant dans les épitaphes et les noms inscrits sur les tombes, que dans ceux gravés sur les monuments aux morts, sur certains bâtiments (pensons aux plaques apposées là où ont vécu – et sont morts – des gens célèbres), ou sur les mémoriaux de toutes natures. Car le phénomène est intimement lié aux guerres contemporaines : elles ont été, à lire l’auteur, le cata lyseur de ce nouvel impératif mémoriel, depuis au moins la guerre de Sécession, en tout cas avec la Grande Guerre, avant que la Seconde Guerre mondiale et la Shoah représentant le moment de « terrible maturité » (p. 591) de cette évolution.
Localiser et nommer les morts, pour que la mémoire s’en conserve, tel est peut-être la principale nouveauté dont notre monde contemporain hérite d’évolutions profondes, engagées depuis au moins le XVIIIe siècle, et rendues plus aiguës par les violences de masse du XXe siècle. « Sur les immensités de l’histoire/plane un spectre/le spectre de l’indéfini » (p. 485), écrit le poète Zbigniew Herbert à propos de l’es- timation des pertes humaines. L’enjeu n’est pas seulement scientifique : cet indéfini est désormais insupportable, pour des femmes et des hommes pris dans un système de sensibilité à la mort, et au mort, profondément renouvelé. ❚