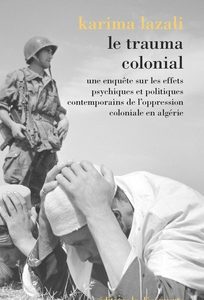 Karima Lazali
Karima Lazali
Paris, La Découverte, 2018, 282 p.
Il existe nombre d’études sur l’Algérie, de la conquête à nos jours : sur l’histoire, l’ethnologie, la sociologie, les représentations littéraires – mais peu ou pas de travaux d’inspiration psychiatrique ou analytique : le champ d’études ouvert par les travaux pionniers de Frantz Fanon (1925-1961) est resté sans continuateurs. C’est dire l’intérêt de l’ouvrage de Karima Lazali, qui se fonde à la fois sur sa pratique clinique, en français et en arabe, en France et en Algérie – mais aussi sur l’histoire, y compris le légendaire, qu’elle prend en compte et déconstruit, et sur la littérature, rejoignant ainsi les postcolonial studies. Qu’advient-il du trauma colonial quand (apparemment du moins) la situation coloniale a disparu ?
Son expérience clinique amène Karima Lazali à constater que, pour les patients algériens, la « révolution de l’intime » cherchée dans la cure reste inachevée. En effet, la psychanalyse en Algérie, au lieu d’être comme d’habitude un processus de déconstruction, est prise dans l’urgence d’une réparation, liée notamment à la guerre civile (1992-2000). La population n’a plus confiance dans les institutions qui « ont perdu leur fonction de tiers protecteur, dans un pays qui a été fortement socialiste en généralisant la gratuité (des soins, de la scolarité, de la justice.) » (p. 22) Mais surtout, se produit un nouage délétère entre la langue, le religieux et le politique, qui ne cesse de réitérer la violence : c’est ce que démontre tout le livre.
Tout part de « l’effraction coloniale ». La conquête de l’Algérie se fonde sur la double fiction d’un peuple dépourvu d’histoire1 et d’une exportation des principes républicains, cruellement démentie par les faits : « ce qui a succombé au refoulement en métropole par la République se redéploie alors pleinement en territoires colonisés : la haine des principes républicains sera une constante de la politique coloniale. » (p. 47) Le colonisateur s’emploie à briser les filiations, en modifiant ou en effaçant les noms des personnes et des lieux : « cette tentative d’effacement de tout élément hétérogène inscrit le colonialisme comme noyau totalitaire de la République française. » (p. 78) On pouvait s’attendre à ce que la guerre d’indépendance répare ces ravages, notamment en restaurant les langues interdites, et ce qui avait été confisqué par la colonialité, mais ce n’est pas le cas.
En effet, l’indépendance « s’est accompagnée de la part des nouveaux dirigeants d’une série de meurtres non reconnus, de falsifications et de détournements des langues, de l’histoire et du religieux. » (p. 105) Il s’agit toujours, comme du temps du colonat, d’« éliminer l’élément hétérogène au système du pouvoir unique… » (p. 106-107) Dès avant l’indépendance, à partir de 1950, les mouvements indépendantistes étaient minés par des luttes fratricides, qui se continueront après 1962. Ces luttes, encouragées par le système colonial en tant qu’elles affaiblissent l’adversaire, ont pour résultat l’absence d’élites et de leaders. L’analyse, qui se réfère ici à Totem et Tabou, suggère en pointillé une généalogie qui peut concerner toute forme de pouvoir politique (p. 148-150).
Qu’en est-il de la langue, et de la littérature ? En 1938, l’arabe est décrété « langue étrangère » au sein de la colonie. Les écrivains algériens « vont réussir à détourner l’ordonnancement politique des langues (arabe, française et tamazight) pour faire de la langue française le lieu d’hébergement des langues interdites. » (p. 157-158) Or, après l’Indépendance, les pouvoirs politiques partaient bien d’une intuition juste : « réparer les effets du colonial par la langue », mais ils l’ont dévoyée. Le fait que l’arabe littéral soit décrété langue nationale a pour effet de « reléguer, comme pendant la colonisation, les langues maternelles au statut de “dialectes” […] L’opposition et le refus de la colonisation française n’ont fait que renouer avec la colonisation… arabe. » (p. 159) On en arrive à ce paradoxe que, lors des émeutes de 1988, qui sont à l’origine de la guerre civile, « le pouvoir en place, très souvent francophone, s’adresse à la population dans une langue étrangère : l’arabe littéral. […] qui ne pouvait faire interlocution. » (p. 166) Cette guerre, que Lazali préfère appeler « guerre intérieure », est à la fois une suite des violences coloniales et de la guerre de libération : « le pacte démocratique est un évitement de la guerre de l’entre-soi, puisqu’il y aménage du différent. L’annulation des élections en janvier 1992 s’est donc inscrite dans le registre d’une conflictualité impossible. » (p. 187)
Aux morts de cette guerre (200 000 morts officiels) s’ajoutent entre 15 000 et 20 000 disparus, enlevés car suspectés de « terrorisme » (p. 214) mais aussi les nombreux exilés, et, effets plus ou moins directs, des cancers foudroyants, des AVC, des arrêts cardiaques : « emballement de la mort dans le corps du vivant » (p. 202). Lazali distingue ici entre terreur et trauma : « le sujet traumatisé n’en meurt pas, bien que son rapport au vivant soit fortement entamé, alors que le sujet terrifié en meurt, très souvent. » (p. 204) Car « la cessation d’une guerre ne met point de terme à ce qui se poursuit de terreur dans le psychisme et dans le social. » (p. 205) C’est d’autant plus vrai que le pouvoir a voulu, par la « loi de réconciliation », imposer le silence sur les disparitions que lui-même avait organisées, ce qui ne résout évidemment rien : « cette réhabilitation […] [est] une fabuleuse machine à produire de la réitération. » (p. 211) L’auteur suggère plus loin une sorte de continuité entre les accords d’Évian, qui organisaient l’amnistie, et la loi de réconciliation (p. 254). Détail sinistre, les familles, pour obtenir une indemnisation, doivent signer un certificat de décès… alors que le corps du disparu est introuvable (p. 215). Beaucoup s’y refusent.
La littérature a ici une fonction critique, qu’elle revêtait déjà du temps de la colonie. Tout au long de l’ouvrage, Karima Lazali se réfère aux écrivains qui ont vécu la guerre d’indépendance (Kateb Yacine, Jean El Mouhoub Amrouche, Nabile Farès, Yamina Mechakra) comme aux plus récents (Samir Toumi, Chawki Amari, Kamel Daoud…). Certes, leur impact est faible sur le public, et sans effets à court terme. Il n’en reste pas moins porteur d’une distance salutaire par rapport à l’événement. Dans Les Chercheurs d’os, le superbe roman de Tahar Djaout, il s’agit pour les familles des morts de « produire » le cadavre pour accéder au statut avantageux de famille de chahid (martyr) mais le roman dépasse la dimension satirique pour devenir « texte testamentaire sur la mélancolisation des vivants à la recherche de leurs disparus et des morceaux de corps éparpillés et sans sépulture. » (p. 261) On se rappelle que Djaout fut assassiné en 1993 (par qui ? )
Comment alors « en finir avec la damnation coloniale ? » (p. 263) L’auteur revient ici sur les travaux de Fanon, qui étudiait les phénomènes de transe et de possession, les rituels maraboutiques, non seulement pour connaître les savoirs en usage chez ses patients, mais pour accéder à la violence de l’univers colonial, violence qui constitue une « autorisation à halluciner » (Fanon cité p. 267) pour échapper à ce réel insupportable. Il s’agit d’en sortir, notant au demeurant que, pendant la guerre d’indépendance, les pratiques traditionnelles de dépossession avaient tendance à disparaître… (p. 268) À partir des intuitions de Fanon sur le trauma colonial, Lazali propose de « faire du trauma une source de perpétuelles inventions pour la pensée et le politique. Et créer des lieux de mémoire autres que la réitération pour les générations à venir. » (p. 272) Le livre, loin de reconduire le discours bien connu de la plainte – ou de la révolte –, propose une analyse politique pour le présent et le futur.
1 Le chapitre 8 développe les légitimations imaginaires de la colonie par la « latinité ».
