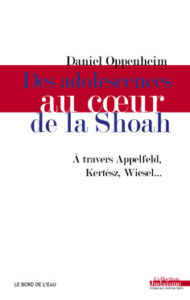Daniel Oppenheim
Lormont, Éditions Le Bord de l’eau, collection « Judaïsme », 2016, 192 p.
Dans ce livre, Daniel Oppenheim, psychiatre et psychanalyste, auteur de plusieurs ouvrages autour de problématiques juives, se met à l’écoute d’une petite dizaine de survivants devenus écrivains – huit hommes mais une seule femme ! Quel dommage pour ces huit écrivains et témoins de n’être en compagnie que d’une seule femme admirable, fût-elle Ruth Klüger. On pense bien sûr à Anna Langfus, Ana Novac, à Charlotte Delbo, qui bien que non juive nous a laissé un témoignage exceptionnel sur Auschwitz, où elle passa plusieurs mois avant d’aller dans un autre camp. Mais Daniel Oppenheim n’en donne pas moins à réfléchir avec cette « poignée de la poussière battue par les vents de la mort », dont Malraux parla avec son éloquence et son génie, lors du trentième anniversaire de la libération des camps de femmes politiques, en 1975, devant le portail royal de Chartres.
Daniel Oppenheim, par l’intermédiaire de tous ces témoins – depuis Otto Dov Kulka, Stanislas Tomkiewicz, psychiatre, qui connut au ghetto de Varsovie un maître en psychiatrie et en pédagogie, le grand Janusz Korczak, mort à Treblinka avec son assistante et leurs deux cents orphelins, jusqu’à Ruth Klüger et Elie Wiesel –, tente d’apporter un enseignement, si enseignement il peut y avoir, en tout cas une leçon de vie. Chaque auteur, chaque survivant rencontré ici par l’auteur, offre une parole unique, un silence unique, je dirais aussi, en pensant en particulier à Wiesel (à qui me lia une amitié de plus de trente ans), un « chant » unique, même si cette parole, ce silence, ce chant deviennent enseignement. Plus qu’il ne délivre un enseignement, chaque témoignage, chaque témoin ici présenté parvient malgré tout à communiquer avec sa force ou sa douceur, avec sa voix intérieure et son discours, avec sa souffrance et sa mémoire traumatique de l’impensable et de l’impensé. Comment croire, comment imaginer soixante-quinze ans plus tard, que des trains convergeaient jour et nuit, deux, trois, voire quatre ans de suite, presque de façon ininterrompue, vers ces lieux de mise à mort, vers ces camps d’extermination, sans que rien, oui sans que rien ni personne au monde vienne interrompre ces trajets voulus vers l’Enfer ?
Que des millions d’êtres – six millions de Juifs et combien de millions de non-Juifs depuis les soldats soviétiques jusqu’aux Tziganes – aient ainsi été exterminés durant toutes ces années, alors que toutes les puissances alliées savaient, est la question qu’Elie Wiesel, Imre Kertész, Primo Levi ou George Steiner, par exemple, posèrent sans relâche mais qui restera à tout jamais sans réponse… Il est si difficile, voire impossible, de se le représenter aujourd’hui. Sans doute seules peuvent en avoir une vraie conscience – hormis les historiens – deux sortes de personnes mais pas trois ni quatre : d’abord, les enfants ou petits-enfants ou témoins de survivants, d’autre part, des personnes qui savent que le pire est toujours imaginable. La majorité des autres l’ont effacé de leur mémoire ou le nient, eux et leurs enfants, comme quelque chose qui fait tache, quelque chose de proprement inimaginable et d’impardonnable jusqu’au bout de l’humanité – aussi impardonnable que les plus grands génocides commis dans l’histoire… et qu’il faut évacuer non seulement de sa mémoire mais de la mémoire universelle.
Né onze ans après la mort de Kafka, Otto Dov Kulka, Juif pragois, fut déporté à dix ans à Theresienstadt d’abord, à Auschwitz-Birkenau ensuite, où lui, sa mère et sa famille maternelle sont regroupés dans le Familienlager, le « camp des familles » autrement désigné par BIIb. Il a raconté son histoire dans Paysages de la Métropole de la Mort (1984), qui n’a pas d’équivalent dans la littérature concentrationnaire, puisqu’il rapporte le trauma de l’enfant de dix ans qu’il était à l’aune de son regard d’historien. Dans ce livre, Kulka nous donne sa vision de l’illustre parabole du Procès : la porte de la Loi (Vor dem Gesetz). Kafka a écrit là un texte hallucinant, inspiré au plus haut sens du mot :
L’homme de la campagne, au dernier jour de sa vie, dit au gardien :
« – après tout, c’est la porte de la Loi, et la porte de la Loi est
ouverte à tout le monde.
– Oui. C’est exact, répondit l’homme.
– Pourtant, depuis des années que je suis assis, personne n’a
franchi cette porte […].
Cette porte n’est ouverte que pour toi. »
Il s’agit ici d’un paradigme valable aussi bien en Chine qu’en Inde, qu’en Afrique, que partout ailleurs. Nul ne peut comprendre alors pourquoi l’homme de la campagne ne força pas la porte. Mystère d’une obscurité totale. Kulka, devenu historien en Israël, l’a relu à la lumière de l’expérience du garçon de dix ans qu’il fut à Birkenau. Il établit un parallèle stupéfiant entre cette porte unique et Auschwitz, Métropole de la Mort, « seule entrée et sortie – une sortie, peut-être, ou une fermeture –, l’unique qui existe pour moi seul » (Kulka, p. 132) Puis Kulka ajoute des propos d’une portée universelle : « Cette porte que Kafka a ouverte, qui était destinée à une seule personne, à K., Joseph K., est en fait ouverte à presque tout le monde. Mais pour lui il n’y avait qu’une porte dans sa mythologie privée. » (ibid.)
Daniel Oppenheim est – comme nous – saisi par son enquête, sa quête indicible, qu’il appréhende donc avec d’autant plus de détermination. Dans ses pages sur Ruth Klüger, il fournit un commentaire salutaire aux déclarations de l’universitaire, professeure de littérature allemande aux États-Unis et aussi en Allemagne. En effet, à l’un de ses étudiants allemands qui s’étonne qu’un rescapé des camps exprime des opinions racistes, elle répond : « Auschwitz n’a jamais été un établissement d’éducation d’aucune sorte, et surtout pas d’éducation à l’humanité et à la tolérance. Il n’est absolument rien sorti de bon des camps, et il en attendrait une élévation morale ? » (p. 86). Les chapitres consacrés à Wiesel, à Otto Dov Kulka, à Stanislas Tomkiewicz, approfondissent la question mais n’y répondent pas de la même manière. Ruth Klüger elle-même y répond à sa façon, directement certes, mais par sa vie elle y a répondu d’une autre façon : par l’enseignement… comme Wiesel. Pour Tomkiewicz, avoir survécu à l’horreur de la Shoah fut aussi « la vocation de toute une vie » (p. 101). Comme le rappelle ici Daniel Oppenheim, dans L’Adolescence volée, le psychiatre franco-polonais analysa sa vocation à travers le prisme de son expérience affreuse et terrifiante de la déshumanisation, de la culpabilité changée en responsabilité ; d’où son travail sur les jeunes qui furent toujours les premières victimes, dans toutes les dictatures, dans tous les génocides.
Daniel Oppenheim retrace avec sobriété et force les grandes étapes de la vie de son confrère Tomkiewicz (Varsovie, 1925-Paris, 2003) : « La mort de son frère et de ses parents, sa déportation, sa fuite hors du train de la mort, sa deuxième déportation à Bergen-Belsen, sa libération du camp, sa lecture du livre écrit pas sa sœur et celui écrit par une jeune adolescente déportée, son expérience des hôpitaux parisiens et de leurs médecins antisémites, le refus de son maître de le soutenir pour l’agrégation de médecine, sa décision de devenir un simple psychiatre d’adolescents et non un grand professeur de médecine » (p. 106). Nous sommes pris à la gorge quand Tomkiewicz s’interroge : « Je ne puis fixer la date précise où j’ai commencé à lutter contre la haine dont j’étais rempli. Est-ce le 13 avril 1945, quand je n’ai pas voulu participer à la curée organisée contre un vieux SS décati, le dernier de nos gardiens ? » (ibid.) Le travail de Stanislas Tomkiewicz fut, au sens le plus haut du terme, cathartique et rédimant : « Pour ne pas s’enfermer dans le rôle de la victime il prend sur lui celui du meurtrier » (p. 104-105). Un jour de grande rafle, en 1942, dans le ghetto de Varsovie, il réussit à fuir mais ne retrouva pas sa fiancée une fois la course folle terminée. Culpabilité sans limite !
Kulka voudrait pour sa part comprendre pourquoi il apprit à chanter avec des enfants de son âge, entraîné par Imre, un chef de choeur, un homme d’exception sachant ce qu’il faisait, en apprenant à des enfants promis à la mort l’Ode à la joie de Schiller de la Neuvième Symphonie de Beethoven à quelques centaines de mètres des crématoires. Daniel Oppenheim nous entraîne sur les cimes les plus vertigineuses de la pensée humaine, du Mal absolu et de ce que Elie Wiesel nommait « l’anatomie de la haine ».
Bibliographie
Klüger Ruth, 1992, Refus de témoigner. Une jeunesse, traduit de l’allemand par Jeanne Étoré, Paris, Viviane Hamy, 2005.
Kulka, Otto Dov, 1984, Paysages de la Métropole de la Mort. Réflexions sur la mémoire et l’imagination, traduit de l’anglais par Pierre-Emmanuel Dauzat, Paris, Albin Michel, 2013.
Publié dans Mémoires en jeu, n°4, septembre 2017, p. 134-135