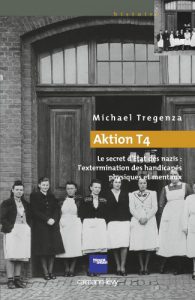Michael Tregenza
Traduit de l’anglais par Clatre Darmon, Calmann-Lévy, 2011, 528 p.
Le livre de Michael Tregenza, historien spécialiste du camp de Bełżec, constitue l’un des rares essais, traduit en langue française, sur la vaste entreprise nazie qui a été nommée l’« Aktion T4 » durant le IIIe Reich et qui désigne l’extermination systématique en masse des handicapés physiques et mentaux d’Europe.
Il semble que ce sujet soit, malheureusement, très peu exploité, bien que nous trouvions des ouvrages, mais qui n’ont pas été traduits, notamment celui d’Ernst Klee : « Euthanasie » im NS-Staat : Die « Vernichtung lebensunwerten Lebens », paru en 1983. L’essai de Michael Tregenza constitue une impressionnante enquête, très fournie, complète, riche et amplifiée d’annexes importantes. Le travail de l’auteur est remarquable parce qu’il n’épargne aucune question et se base sur un ensemble de témoignages, études, recherches sur le terrain, etc.
L’essai, en suivant un parti pris quasiment narratif, permet de comprendre l’évolution, de son commencement à son achèvement, de cette entreprise perçue par les nazis comme une réussite. L’Aktion T4 tire son nom de l’adresse où se situait le bureau central II, dirigé par Viktor Brack, au n° 4 de la Tiergartenstrasse ; six centres d’euthanasie seront installés en Allemagne : Grafeneck, qui constituera un point de départ, avec un château isolé dans les Alpes Souabes, Brandenbourg, Hadamar, Bernbourg, Hartheim et Sonnenstein.
Ce « secret d’État des nazis » désigne une grande « euthanasie » – bien que la terminologie utilisée par les nazis, Michael Tregenza le rappelle bien, repose sur un processus d’euphémisme – au nom d’une certaine « hygiène raciale » (24) invoquée par Hitler et son « aversion pour les défigurations » (35). Les enjeux de la politique eugéniste nazie se superposent aux objectifs économiques en période de guerre : libérer des lits d’hôpitaux, économiser de l’argent, mobiliser médecins et infirmiers pour les blessés de guerre, etc. En effet, les nazis – pour lesquels il n’existe que deux catégories d’individus à ce moment-là, les utiles et les inutiles – voient le fonctionnement des asiles comme un grand gaspillage d’argent. Hitler devint ainsi « le médecin de la nation allemande » (52). C’était alors, pour lui, la mise en place d’un plan d’économie radical en temps de guerre, permettant l’élimination de « bouches inutiles » et d’« âmes impropres à la vie ».
Les recherches minutieuses et détaillées de l’historien permettent de comprendre l’effrayant processus de l’ex termination, de sa genèse à son accomplissement qui tient aussi beaucoup à la dissimulation, à l’absence de prise de conscience et au silence extrême : « l’entreprise d’euthanasie tout entière dépendait du silence » (181), mais ce silence ne fut pas total.
Dès 1934, des affiches de propagande sont placardées un peu partout, montrant des photographies de malades mentaux et comportant des légendes comme la suivante : « ce malade mental coûte actuellement 2 000 marks à l’État ». C’est ainsi que « les nazis firent de la maladie un crime « (58).
Michael Tregenza explique que cette extermination a pour point de départ le « dossier K », désignant un nouveau-né à qui il manque les deux jambes et l’avant-bras droit, et qui souffre d’une déficience mentale. Les parents de cet enfant ont envoyé une lettre à Hitler en lui demandant d’accorder une « mort miséricordieuse » (49) à leur enfant. Ce sera la première victime de l’« euthanasie », le « catalyseur à l’entreprise nazie » (54) qui mettra, dès lors, « la science au service de l’inhumanité » (185).
L’essai montre que cette vaste et morbide entreprise constituait, par plusieurs aspects, une préfiguration des camps d’extermination : tout d’abord, la définition de « handicapé » était particulièrement floue et intégrait plutôt tous les êtres que les nazis voulaient anéantir : ainsi des aveugles, sourds, « idiots » légers, etc. Les prostituées étaient également persécutées : Tregenza évoque notamment l’épisode des prostituées jetées dans une tranchée et massacrées avec des grenades (459). On ne s’étonnera donc pas que tous les pensionnaires d’asiles qui ne pouvaient travailler étaient d’avance condamnés.
Dans l’intérêt de l’explicitation entre l’euthanasie et la « solution finale », il faut aussi mentionner, peut-être, l’extermination de malades polonais, qui étaient fusillés (C. Browning, Les Origines de la solution finale, 202-212). Les patients étaient enfermés, nus, sans distinction de sexe, dans des chambres où était diffusé du monoxyde de carbone pur (considéré comme inodore et indolore par les nazis). Les malades, assis sur des bancs, tombaient les uns après les autres. Certains observaient leurs camarades mourir avant de sombrer à leur tour, ce qui pouvait provoquer des crises de panique, tout comme la valve de gaz qui, si elle était ouverte trop rapidement, émettait un sifflement qui était perçu par les personnes enfermées. Après le gazage, les corps étaient transportés et jetés dans des fours crématoires qui, parfois trop remplis, provoquaient des incendies dans la cheminée. Les ossements qui n’étaient pas complètement carbonisés étaient écrasés et réduits en poussière à l’aide d’un marteau ou d’un moulin. Après quoi, ces « cendres » mélangées étaient mises dans des urnes avant d’être envoyées aux familles des victimes qui les réclamaient. « Le meurtre industrialisé était né » (189).
Il arrivait que les SS effectuent des expériences scientifiques au nom d’une « recherche médicale » morbide : les cerveaux et divers organes de quelques patients étaient alors retirés pour « expérience » médicale, l’essai prouve que ce ne sont pas de simples légendes. C’est de cette façon que « les malades mentaux commencèrent à disparaître sans laisser de trace » (116) jusqu’à atteindre, finalement, le nombre de 70 273.
Plusieurs figures de témoins parcourent cette enquête : médecins, infirmiers, habitants voisins, proches des victimes, etc., ce qui permet une vision large et panoramique des événements. Le livre répond également à toutes les questions que le lecteur est en droit de se poser : comment réagissaient les habitants des villages situés à côté des châteaux ? Existait-il une forme de résistance ? Y a-t-il eu des révoltes ? Tregenza évoque les cas d’envois de lettres aux administrations des forts, souvent anonymes et menaçantes, visant à faire cesser les assassinats, ainsi que celui d’une infirmière psychiatrique qui a tenté de pénétrer le château de Grafeneck pour comprendre ce qu’il s’y passait.
À côté de ces figures-témoins, on trouve les descriptions précises et détaillées, avec de petites biographies, des « monstres » de cette vaste entreprise, persuadés du bienfondé de leur «mission». Parmi ces derniers, plusieurs noms reviennent, dont celui de Christian Wirth, « un homme à la disposition du Führer » (61), « énergique et physiquement très fort, Wirth ne tolérait aucune opposition et faisait preuve d’une extrême irascibilité. Il était sans pitié, implacable et inflexible » (62). L’alcool était un autre élément important de l’Aktion T4. En effet, Wirth et ses homologues contrôlaient efficacement les corps et les esprits de leurs équipes en les approvisionnant constamment, des fêtes étaient même organisées dans les forts, qui devenaient parfois de grands festivals de débauches – ce qui gênait quelque peu Himmler.
L’importance de ce livre particulièrement saisissant tient à l’ampleur du processus nazi de destruction qu’il met clairement en évidence. En corollaire de l’anéantissement d’autres communautés durant la Seconde Guerre mondiale (Les Juifs, les Tziganes, les Noirs, les homosexuels), il engage à entretenir la mémoire de ceux qui, même de leur vivant, étaient dépourvus des moyens de résister contre leurs assassins et, a fortiori, de réclamer justice.
Yoann Sarrat
Paru dans Mémoires en jeu, n° 1, septembre 2016, p. 140-141.