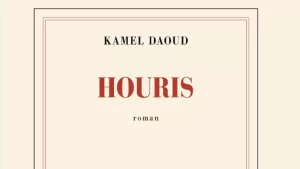 Comment parler d’un livre que tout le monde a déjà lu ? Houris, entre prix Goncourt et interdiction en Algérie, a fait tant de bruit qu’il est difficile d’en faire abstraction. Essayons tout de même d’en proposer une lecture au premier degré, quitte à interroger pour finir les usages possibles du texte.
Comment parler d’un livre que tout le monde a déjà lu ? Houris, entre prix Goncourt et interdiction en Algérie, a fait tant de bruit qu’il est difficile d’en faire abstraction. Essayons tout de même d’en proposer une lecture au premier degré, quitte à interroger pour finir les usages possibles du texte.
Le bandeau de couverture, avec les frondes de ses palmiers et la silhouette féminine voilée, en longue robe claire, pourrait évoquer le paradis promis aux bons croyants – n’était que la silhouette est inclinée sur un smartphone et que le mur derrière elle est balafré d’une climatisation. L’image joue avec les clichés d’un bonheur paisible, à l’ancienne, et les signes discrets de la modernité, mais elle est trompeuse, malgré la légère tension qu’elle suggère : car le récit est traversé par une violence venue du fond des âges, d’avant le Coran que brandissent certains des protagonistes, d’avant l’Ancien Testament et ses sacrifices humains – et ensanglantant sans surprise notre siècle.
Violence portée d’abord par une voix, et amenée à un tel degré d’incandescence que le lecteur se demande comment l’auteur va pouvoir poursuivre. Celle qui parle se décrit d’emblée avec son « grand sourire ininterrompu », la terrible cicatrice de son égorgement quand elle avait cinq ans, survivante improbable et taraudée par la culpabilité. Elle dit s’appeler Fajr, « Aube dans la langue intérieure » (19), mais aucun de ces prénoms n’est le vrai, le vrai ne surgira que beaucoup plus tard. « Je cache l’histoire d’une guerre entière, inscrite sur ma peau depuis que je suis enfant. » (20)
Elle se décrit à quelqu’un qui n’a pas encore de voix ni de visage, avec « la langue de ce qui ne possède pas de langue. » (17) : l’enfant qu’elle porte dans son ventre, et à qui elle a promis de la tuer, pour lui éviter de vivre dans ce pays où les femmes sont en butte aux interdits et aux désirs brutaux des hommes : « c’est un couloir d’épines que de vivre pour une femme dans ce pays. Je te tuerai par amour.» (26)
Petite écolière, à dix ans, lors d’une composition d’histoire, elle avait crânement écrit : « Pour moi la guerre d’Algérie a commencé et a fini le 31 décembre 1999 dans les montagnes du Ouarsenis et non le 1er novembre 1954 dans les chaînes des Aurès… » (118) ce qui lui avait valu une convocation chez le directeur de l’école. Jeune femme, elle n’écrit pas, mais son salon de coiffure s’appelle Shéhérazade – raconter contre la mort – et ses pantalons, ses cigarettes, ses cheveux au vent sont une provocation permanente contre l’idéologie dominante. Elle n’a pas pris la décision de raconter, elle est elle-même le témoin, la mémoire vivante, et insupportable à ce titre, contre ceux qui « oublient comme ils respirent » (107), elle est un livre : « le livre qui protège de l’oubli la véritable histoire de la vraie guerre d’Algérie.» (32)
Cette « vraie guerre », ce n’est pas la « guerre contre la France », qui « se comporte comme une enfant unique qui s’empare de toutes les commémorations », (116) avec d’autant plus de facilité que le 29 septembre 2005, « jour de la réconciliation des meurtriers avec les meurtriers » (126), une loi, que Daoud cite en épigraphe, punit de prison quiconque « utilise ou instrumentalise les blessures de la tragédie nationale ». La vraie guerre, impossible à désigner, a eu lieu bien après la guerre d’Indépendance. Et l’histoire pourrait s’arrêter là : un terrible témoignage sur la « décennie noire » – le terme de guerre civile étant controversé – une variante romanesque, suite aux nombreux et divers écrits sur la période, recensés par Tristan Leperlier dans Algérie, Les écrivains dans la décennie noire[1].
Mais une relance se fait, avec l’apparition d’un personnage qui semble d’abord une fausse piste, ou une dérivation : Aïssa (le nom de Jésus dans le Coran), une sorte de Bon Samaritain qui recueille la jeune femme en perdition sur l’autoroute. Au fait, que faisait-elle sur l’autoroute, pieds nus, vêtements déchirés, blessée, peut-être violée, alors que quelques pages auparavant nous l’avions laissée au volant de sa voiture, en route pour son village natal-mortel ? On ne le saura que plus loin, mais il faut signaler dès maintenant l’art du suspense de Daoud, qui chamboule la chronologie et joue avec les nerfs du lecteur en lui distillant les informations petit à petit. C’est pourquoi le personnage d’Aïssa, qui peut paraître d’abord hors d’oeuvre, obligeant le lecteur à entendre une autre voix que celle d’Aube à laquelle il s’était accoutumé, a en fait deux fonctions, d’inégale importance. La première est d’être le comptable ou le scribe des meurtres et disparitions de la guerre civile, dont il est capable de relater les chiffres, dates et circonstances sur demande. L’économie narrative permet de penser que, dans la mesure où Aube, enfermée dans son malheur et son deuil, ne possède pas toutes les informations, Daoud utilise ce nouveau personnage pour faire apparaître l’ampleur et l’horreur des massacres. Aïssa ne donne guère de détails, se bornant le plus souvent à des énoncés factuels, énoncés qui sont enrichis plus loin par divers récits enchâssés, recueillis par Aube. Libraire-itinérant, il a été blessé par les islamistes, qui l’épargnent pour qu’il raconte : « l’Émir des égorgeurs m’a demandé d’aller partout raconter ce que j’avais vu, sauf que je n’ai rien emporté, aucune preuve. Vingt ans après, personne ne me croit plus. » (175) C’est pourquoi à ses yeux, Aube avec son affreuse cicatrice est un signe du ciel : elle valide son histoire, alors que personne ne veut plus écouter sa litanie d’ hypermnésique fou : « On me donne un chiffre, j’indique la date d’un massacre, le lieu, parfois les prénoms des morts. » (233)
La seconde fonction du personnage est, si l’on peut dire, plus anecdotique : à l’avant-dernier chapitre, alors qu’Aube est prisonnière de l’imam boucher (ce n’est pas une métaphore) et de son frère jumeau vendeur de viande d’âne, et qu’elle attend l’égorgement ultime, Aïssa intervient en mode Zorro, et l’auteur ne prend pas la peine de justifier comment il arrive : « Je t’ai retrouvée, ma sœur. Je t’ai suivie, j’ai écouté ton chiffre, tes mille morts depuis midi. » (409) C’est un gag, on n’y croit pas, on a plutôt envie de sourire de ce deus ex machina. Et l’on ne croit guère non plus au happy end du tout dernier chapitre : Aube a renoncé à tuer sa fille dans son ventre, elle a accouché, on est « un an plus tard » (410), à la plage, sa mère est heureuse d’être grand-mère, Aïssa est là aussi sur un petit tapis de plage, et c’est un Noël en plein été autour de de la divine Enfant, prénommée Kalthoum comme Oum, la célèbre chanteuse égyptienne. Cette fin qu’on serait tenté de dire bâclée, tant elle détonne après le drame, est-elle un pied de nez au lecteur, un simple rappel des pouvoirs de la fiction, ou une ultime ironie, qui ne cherche pas à être crédible, après tout ce qui est advenu?
Car tous les malheurs qui assaillent l’héroïne ne sont rien auprès de l’épilogue emblématique dans lequel elle retrouve son village, celui où elle doit décider du sort de l’enfant qu’elle porte, et à qui elle n’a cessé de parler depuis le début. Dans ce qui fut le village de sa famille, le village du massacre, dès qu’elle dit son patronyme, portes et visages se ferment : « Il n’y a personne avec son vrai nom ici, ils ont volé les morts et leurs livrets de famille. » (330) Pourquoi est-ce que je pense à la Pologne d’après-guerre, où les Juifs survivants revenus chercher leur maison se sont cognés à des Polonais même pas antisémites peut-être, mais squattant les maisons de ceux qui ne devaient pas revenir ? « L’oubli, c’est la miséricorde de Dieu, mais c’est aussi l’injustice des hommes. » (332)
Un livre qui brutalise le lecteur, par sa crudité, qu’il s’agisse de décrire la blessure et la cicatrice d’Aube ou la technique de l’égorgement. (253-4) Peu d’autres romans sont allés aussi loin, à l’exception de l’étonnant Ravisseur de Leïla Marouane[2], dont la narratrice est aussi une victime de la guerre. Mais qui ouvre aussi nombre de questions. On se rappelle les événements qui avaient émaillé une nuit de fête à Cologne, et la polémique qui s’en était suivie, certains reprochant à Daoud d’attiser l’islamophobie et d’étayer l’extrême-droite raciste[3]. Fera-t-on le même reproche à Houris ? Le livre, interdit en Algérie, y circule paraît-il sous le manteau, le prix Goncourt n’ayant pas pour effet d’arranger les choses. Mais Daoud n’a cessé de lutter contre l’occultation de la mémoire, même si c’était de manière moins frontale. Déjà, dans La Préface du nègre[4], le règlement de compte, ou pour mieux dire l’essai de sortir de la dépendance et de la contre-dépendance, s’y effectuait moins par rapport au colon – ou à la littérature coloniale, que par rapport à l’Algérie indépendante : le « nègre » s’insurgeait contre de nouvelles modalités de l’oppression, le culte du passé, de la tradition, de tout ce qui fige – y compris dans la mémoire institutionnelle de la Guerre de Libération. « Le pays n’avait vécu qu’une seule histoire de guerre et, depuis, ne cessait d’y explorer son propre reflet au point de refuser la guérison qu’avaient connue d’autres peuples. […] » (PN 72) Cette guérison, ou cette sortie de crise, est une question qui dépasse de beaucoup le drame algérien, il suffit de regarder autour de soi …
Près de dix ans avant Houris, Daoud concluait : « L’histoire de ce pays était le livre dont la fin était de dévorer le lecteur après avoir imposé l’anonymat aux auteurs qui essayaient de laisser, tout à la fois, un livre et un nom. » (PN 65)
[1] Tristan Leperlier, Les écrivains dans la décennie noire, Paris, CNRS éditions, 2018.
[2] Leïla Marouane, Ravisseur, Julliard 1998.
[3] Cf. notamment La Repubblica le 10 janvier 2016, tribune reprise par Le Monde le 31 janvier 2016, intitulée « Cologne, lieu de fantasmes », Le Quotidien d’Oran, le 18 janvier 2016, « Nuit de Cologne : Kamel Daoud recycle les clichés orientalistes les plus éculés » dans Le Monde du 11 février 2016, etc. Cf. l’analyse de Kaouthar Harchi, in Je n’ai qu’une langue, ce n’est pas la mienne : des écrivains à l’épreuve, Éditions Pauvert, Paris 2016.
[4] Kamel Daoud, La Préface du nègre, Actes-Sud, Arles, 2015. Désormais PN.
