Alger, rue des Bananiers
de Béatrice Commengé Paris, Verdier, 2020, 128 p.
Tout récit d’enfance est pris dans une double exigence : ressusciter au plus juste les sensations et les savoirs de l’enfant, les mettre en corrélation avec les expériences et les savoirs de l’adulte. Dans le cas d’une enfance qui s’est écoulée pendant les dernières années de l’Algérie française, s’ajoute un défi de plus : comment faire entrer en résonance les joies naïves de l’enfance et les démentis de l’histoire avec sa grande hache ?
Le versant le plus réussi du livre de Béatrice Commengé, c’est celui de l’enfance, avec son nuancier de sensations concrètes : les odeurs, les couleurs, les fruits, les copines, Chakira qui préfère qu’on l’appelle Michelle, le chemin dévalé pour aller à l’école, le cinéma, l’amour des westerns, l’identification au héros Kit Carson (un tueur d’Indiens), les robes de la petite fille, relayées par les photographies conservées par la mère, la fierté du premier jean. Et la saga des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents : on suggère sans insister qu’aucun d’eux n’est venu faire fortune, ce ne sont pas de méchants colons, ce sont des gens qui travaillent, le père est professeur, comme en témoigne cette bibliothèque débordante qui ouvre le livre, et qui, après le retour en France, recèle des rayonnages consacrés à l’histoire de l’Algérie : « L’achat de chacun de ces livres avait été le seul moyen qu’avait trouvé mon père pour que son corps se sente encore relié au pays où il avait vécu jusqu’à l’âge de cinquante ans. » (p. 12) Histoire de famille heureuse, pourtant ponctuée de secrets, que l’adulte découvre peu à peu, premier mariage du père, et que faisait la mère à vingt ans sur la passerelle de ce petit avion Toulouse-Barcelone, je vous le demande ? Cherchant à cerner les vies de ses aïeules, la narratrice a cette formule très heureuse : « J’ignore l’ignorance de Jeanne. » (p. 40) Elle se pose toutes les questions qu’a pu se poser la jeune Jeanne, l’arrière-arrière-grand-mère, en débarquant sur cette terre inconnue, découvrant l’Antiquité romaine en arrivant à Cherchell, ces « vestiges d’une grandeur fatalement brisée par d’autres conquérants », et y répond par sa propre question d’enfant : « Comment imaginer, à l’heure où l’on m’apprend à mettre des mots sur les choses, que ces choses n’ont pas été là de toute éternité ? » (p. 31).
Mais celle qui, aujourd’hui, interroge ses souvenirs et ceux de sa famille veut aussi les placer dans le cadre de l’événement, plus précisément de ce qu’on appelait pudiquement « les événements » pour ne pas parler de guerre. Elle le fait avec un grand souci d’honnêteté, citant ses sources, articles de journaux, livres empruntés au rayon « Algérie » de la bibliothèque paternelle, films d’actualité… Mais intégrer l’information objective – enfin, disons objective – à ses souvenirs personnels s’avère délicat. On peut sourire de la notation qui nous montre le vieux Marx se promenant au soleil d’Alger « cinquante ans avant Eugénie (ma mère) » (p. 45). Mais l’auteur recourt systématiquement à la prétérition, sur le mode « Nul ne se serait douté que, quarante-cinq ans plus tard… », « Ils étaient loin d’imaginer que… ». Donnons-en seulement deux exemples : « J’étais loin d’imaginer, à sept ans, tout à ma joie de dévaler matin et soir les larges marches du chemin Sidi-Brahim, que vingt ans plus tôt, un jeune écrivain fou de théâtre qui n’avait encore rien publié, Albert Camus… » (p. 61), « En ce 14 juillet 1871, ni Jeanne, ni les résistants de Malek el-Berkani ne savaient que deux ans plus tôt, un jeune homme de quinze ans, vivant à Charleville, fils d’un de ces soldats venus conquérir le pays, dénommé Arthur Rimbaud, remportait un concours de vers latins avec un long poème célébrant Jugurtha, le rebelle numide, qui… » (p. 54). Pressentant sans doute que cet effet d’érudition d’une pertinence douteuse peut rebuter le lecteur, Béatrice Commengé recourt parfois à un « présent de narration », comme dans l’épisode de la bombe au Milkbar : « La jeune femme est jolie, elle s’appelle Zohra, elle porte un pantalon et un pull moulant. Elle s’est assise au milieu de la salle et a posé son sac de plage sous la table avant de commander une glace. Elle a regardé les enfants autour d’elle, avec leurs parents. Puis elle s’est levée en laissant le sac sous la table. » (p. 50) L’évocation, deux lignes après, des enfants arabes morts dans l’attentat OAS de la rue de Thèbes, censée rétablir un équilibre, ne « fait pas le compte », pas plus que la page consacrée à La Question d’Henri Alleg. Un livre qui était dans la bibliothèque du père.
Enfant, la narratrice a visité Oradour-sur-Glane. Et d’ajouter : « comme à Melouza ? Mais j’ignore tout de Melouza. » (p. 97) Le lecteur n’en sachant pas forcément davantage, il faut donc lui dire que Melouza, c’est le nom d’un village dont les habitants ont été massacrés, en 1957, par le FLN, parce que soupçonnés de soutenir le mouvement rival de Messali Hadj, massacre que le FLN a tenté d’attribuer à l’armée française. L’allusion, une fois déchiffrée, souligne la cruauté du FLN, comme l’attentat de Palestro, comme les bombes du Milkbar. Les exactions françaises, elles, appartiennent majoritairement au siècle précédent, comme les enfumades de Bugeaud : « Pas une seconde je ne me serais figuré qu’en ces temps où l’explorateur John Frémont demandait à Kit Carson (le vrai) de l’accompagner dans une expédition au Far-West, […] les grottes avaient été enfumées à Dahra. » (p.75)
L’innocence de l’enfance est une réalité subjective forte, et l’auteur le sait. « La manœuvre [c’est ainsi qu’elle désigne la guerre, autre euphémisation comme « les événements »] peut durer longtemps. Celle-ci allait durer huit ans. Huit ans qui m’apporteraient la preuve qu’il était possible, quand on habitait rue des Bananiers, de grandir en pleine manœuvre sans que la joie des jours en fût altérée. » (p. 48) Il n’y aurait rien à opposer à cette évidence subjective, si l’auteur n’avait précisément voulu lui donner un cadre historique, oscillant entre l’information et le regard du témoin qui « n’a rien vu », ainsi après la fusillade de la rue d’Isly : « On tire. Le lendemain, on ramasse plus de cent cadavres. C’est écrit. Je n’ai rien vu. J’étais tout près, à vol d’oiseau. » (p. 116) Tous les enfants sont Fabrice à Waterloo, certes. Mais, publié chez le même éditeur, Une terrasse en Algérie de Jean-Louis Comolli1, autre « récit-d’enfance-pied-noir », avait le mérite de soupçonner ce que voilait l’innocence de l’enfant, et de ne pas se croire chez lui « en pays conquis ».
Canción
de Eduardo Halfón
Traduit de l’espagnol (Guatemala) par David Fauquemberg, Paris, Quai Voltaire, 2021, 120 p.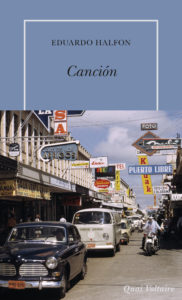
On ne sait pas très bien où est le Liban. Sans doute pas très loin du Guatemala, puisque c’est là que le grand-père, alors âgé de seize ans, est arrivé, fuyant un Liban mystérieux, doté de divers noms étranges, avec un passeport syrien. L’enfant connaît le Guatemala où il est né, mais l’adulte n’ira jamais au Liban, terre pourtant de ses ancêtres : du coup, il est traité d’« imposteur » par un collègue lors d’un colloque sur les écrivains libanais à Tokyo. Et quand on l’y accueille en arabe et qu’il répond en anglais, comment ne pas s’interroger ?
Être guatémaltèque, ou libanais, malgré la distance entre ces deux terres, c’est peut-être cela : ne pas savoir exactement où l’on est dans le cours meurtrier du monde. Le grand-père du narrateur a été enlevé par des guérilleros, puis rendu à sa famille, moyennant rançon, après un mois de captivité où il n’a pas été trop mal traité. Ces guérilleros, l’enfant les a imaginés sales, barbus, vilains, et sera très surpris d’apprendre, bien des années plus tard, que parmi eux se trouvait une belle dame élégante, le grand-père affirmait avoir été séquestré par une « reine de beauté. » Le narrateur parviendra à la rencontrer longtemps après, elle lui parlera, mais en lui faisant promettre de ne rien répéter de son récit.
Mais il ne tient pas vraiment sa promesse en ce sens que, par bribes décousues, il raconte non pas la gué guérilla, mais la guerre trop vraie que les États-Unis mènent en Amérique centrale ou en Amérique du Sud, à tous les gouvernements qui ont tenté de ne pas s’aligner sur les intérêts des grandes compagnies : au Guatemala, quand le président Arbenz a voulu s’en prendre aux terres accaparées par la United Fruit Company, la CIA l’a promptement renversé. Rogelia Cruz, qui avait protesté contre l’intervention du gouvernement états-unien, et qui militait avec le mouvement révolutionnaire, torturée et tuée, était peut-être la reine de beauté qui avait séquestré le grand-père, en tout cas c’est ce que rêve le petit-fils. Le nom de Rogelia vaut pour tous les paysans massacrés par les paramilitaires, pour tous les militants assassinés. « Canción », ce titre mystérieux, qui pourrait simplement signifier « chanson », c’était le surnom d’un des guérilleros qui ont kidnappé le grand-père, et qui finira lui-même assassiné, on ne sait par qui. En contrepoint, un seul récit heureux, celui du gardien de troupeau qui, averti à temps, a pu se sauver ainsi que son bétail pendant que les soldats brûlent sa ferme.
Au Japon, le narrateur rencontre Aïko, qui lui parle de son grand-père à elle : lui n’a pas été kidnappé, mais c’est un hibakusha, un survivant d’Hiroshima, à la peau incrustée du dessin du kimono qu’il portait le jour de la bombe. Quel rapport, peut se dire le lecteur ? L’un des intervenants au colloque des écrivains libanais s’est ainsi exclamé qu’il ne voyait pas l’intérêt de raconter l’histoire d’un éleveur guatémaltèque et de son troupeau de vaches. L’auteur, en juxtaposant la violence des guérilleros et la violence d’État, le kidnapping du grand-père et le meurtre de masse d’Hiroshima ou les putschs fomentés par la CIA, semblerait presque les renvoyer dos à dos. Mais peut-être est-ce une invitation au lecteur à construire un sens entre les différentes pièces du puzzle, qui précisément ne sont pas égales, pas symétriques. C’est le principe même du puzzle. ❚
1 Voir notre recension dans Mémoires en jeu, n° 8, hiver-Printemps 2018-2019, p. 9-10.
